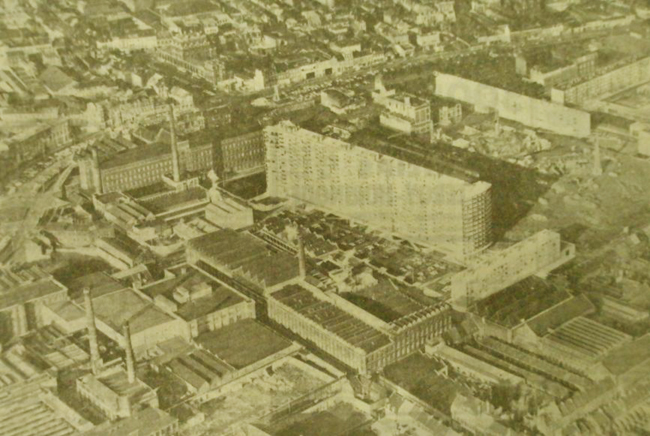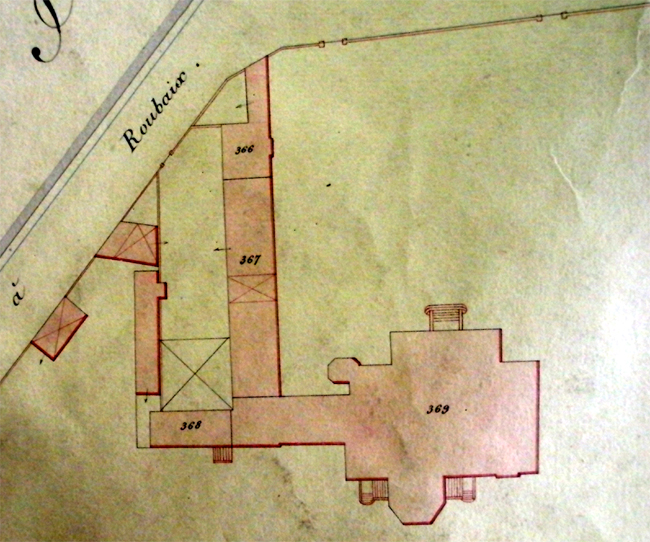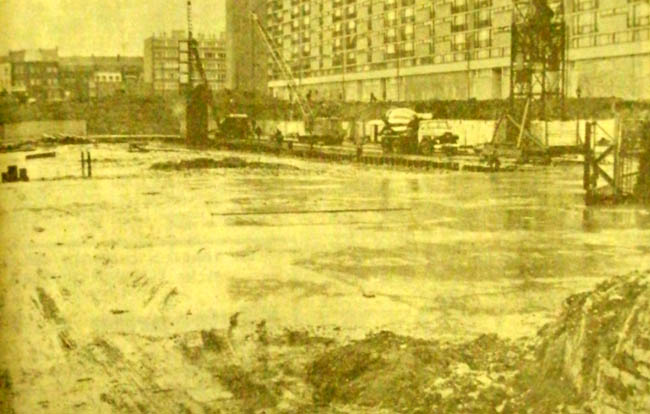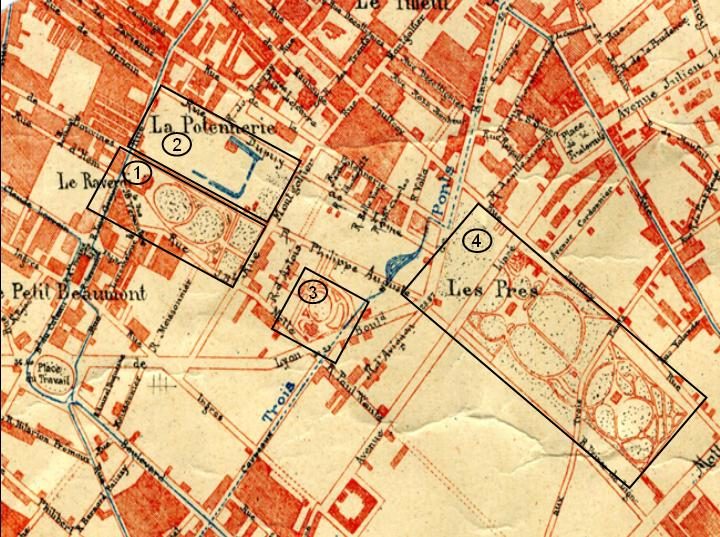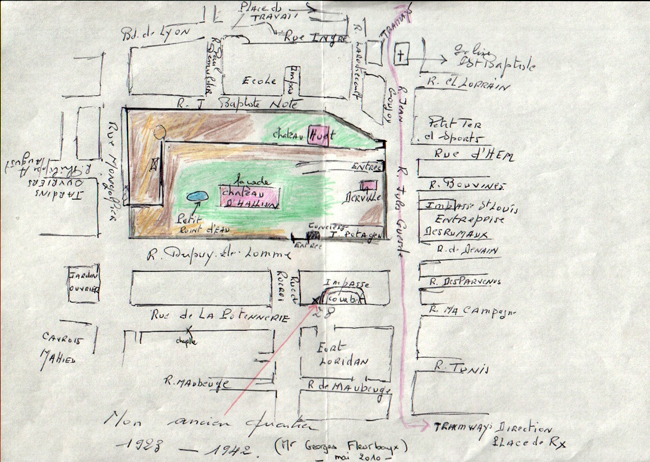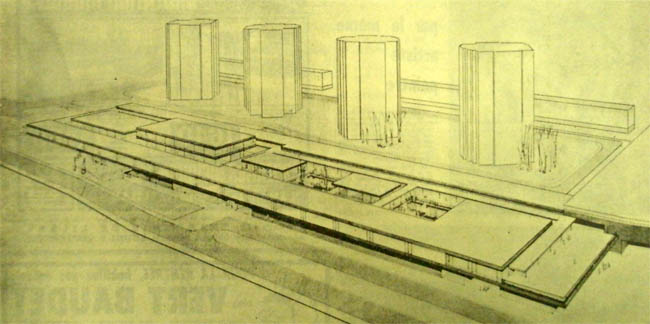J’habitais le bâtiment trois à l’angle de l’avenue Motte et de la rue Rubens, l’entrée était tout au bord de la rue Rubens, on y accédait par un escalier qui tournait, mais on aurait pu y mettre un ascenseur, c’était très grand au milieu et tout ouvragé avec des rampes en fer forgé…
On entrait dans l’appartement par un couloir, et il y avait trois chambres qui faisaient au moins 10 m² chacune. On entrait et il y avait immédiatement l’accès à deux chambres dans l’entrée, et la troisième porte donnait dans le séjour. Il n’y avait pas de salle de bains, on l’a faite après, il y avait une petite cuisine, avec un évier, le gaz qui était sur le côté. Dans le séjour, il y avait une cheminée avec un feu à charbon, car il n’y avait pas de chauffage central. Par la cuisine on accédait à un balcon suspendu qui était très grand et où il y avait les toilettes, et le vide-ordures qui était là au bord du balcon. J’ai connu ça jusqu’en 1965, on était cinq à vivre là, mais les chambres étaient suffisamment grandes, je dormais dans la même chambre que ma sœur.

Pas de travaux, jusqu’à ce que ma mère quitte l’appartement, on a juste changé le carrelage, c’étaient des dalles noires et blanches, qu’ils ont changé dans les années soixante dix. Par contre dans les appartements qui ont été démolis, les carrelages étaient rouges et blancs. Ça m’impressionnait quand j’y allais, j’avais une amie là, je trouvais que c’était beau, et dans les entrées aussi, les montées d’escalier, c’était du carrelage avec des rampes en fer forgé.
Les chambres au sol, c’était du parquet, et les murs c’était en brique avec du plâtre, on pouvait mettre des tableaux, on mettait du papier peint dont on coupait la bordure de gauche, pour le chevauchement. On avait acheté le papier chez Hourez, rue de l’épeule, les plus grands fournisseurs de Roubaix.
L’appartement n’était pas bruyant, c’était bien isolé, bien qu’il n’y ait pas de double vitrage. Je me souviens, comme on n’avait pas de chauffage central, on tirait les rideaux qui collaient aux carreaux. On avait une cheminée avec un feu continu au charbon, et on en faisait provision pendant l’été, c’était moins cher. Après on a eu un poêle à mazout.
La chambre la plus éloignée du feu, donc la plus froide, c’était celle des parents…Dans le séjour, il y avait la cheminée, et on avait deux fauteuils de chaque côté, un bahut, une petite commode et puis la table et les chaises au milieu. Les meubles avaient été fabriqués par un ébéniste de la rue de Lannoy. Pour les chambres d’enfant, on était allés chez Cavalier, rue de Lannoy. La radio était sur la commode, on écoutait la famille Duraton. En 1960, on a eu la télé, surtout pour avoir des nouvelles d’Algérie, où les jeunes étaient partis faire la guerre. Chaque appartement avait son antenne.
Chaque chambre avait un lit et une armoire, il n’y avait pas de placards. Dans la cuisine, il n’y avait pas de meubles, l’évier était presque contre le mur, car il y avait les descentes d’eau. On avait une belle fenêtre, et on mettait la table et les chaises pour déjeuner le matin. Il y avait la gazinière, une petite armoire et aussi une étagère sur le mur. On avait le garde manger sur le balcon, il n’y avait pas de frigo, les jours d’été, il y avait les marchands de glace, qui livraient des blocs. Les gamins allaient aussi chercher des glaces à Monsieur Léon et son triporteur, mais c’étaient des crèmes glacées. Quand les enfants étaient dans la cour intérieure du bâtiment, on pouvait les surveiller de la cuisine. Le sol du balcon, c’était comme du béton, et on pouvait faire couler l’eau, c’était un balcon fonctionnel. Pour l’époque c’était bien, avec le vide-ordures qui se trouvait là. Les gens faisaient attention à leur voisinage, on mettait les ordures dans les journaux, les éboueurs passaient une fois par semaine. C’était un service de la ville. Ils venaient avec un camion découvert, des pelles et des fourches pour ramasser les ordures.
Chaque appartement avait une grande cave et on y stockait le charbon de chez Sergeraert, le charbonnier du quartier, qui se trouvait là où il y a une pagode maintenant, rue Horace Vernet. Pour certains, c’était dur, quatre étages pour monter le charbon ! Après, dans les années quatre-vingt, il y a eu le chauffage individuel.
Après la guerre, les gens ont voulu du moderne. D’abord la salle de bains, puis le chauffage… Après ils ont remplacé le carrelage, en 1978, le parquet était usé aussi… Ces appartements n’étaient pas très pratiques, on devait traverser le séjour pour aller dans les chambres, on vivait beaucoup dans la cuisine. Dans les appartements qui faisaient l’angle, il n’y avait pas de pièce pour la cuisine, c’était la cuisine américaine, intégrée dans le séjour. On s’est fait un coin douche parfois…
Il y avait un toit terrasse. Pour y accéder, on ouvrait une trappe au dernier étage. Pour la course Paris Roubaix, les locataires montaient sur cette terrasse pour être aux premières loges, car l’avenue Motte regorgeait de monde. On était sur plusieurs rangs, on se pressait contre les barrières, ou on venait avec son escabeau.
Texte Christiane