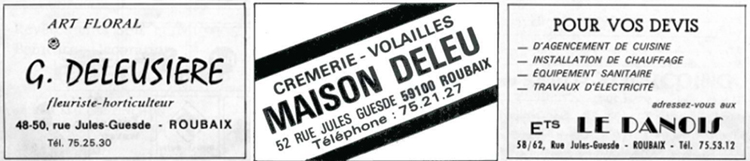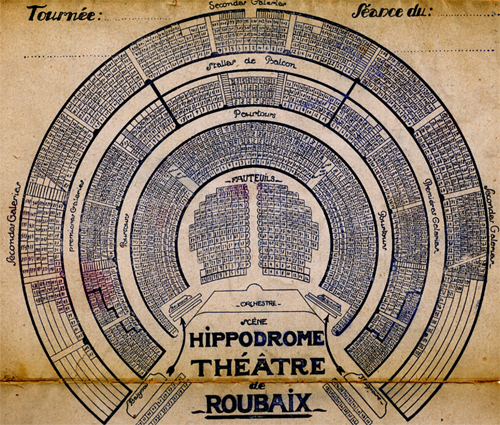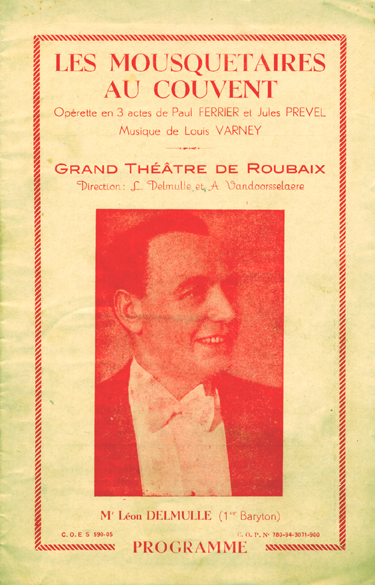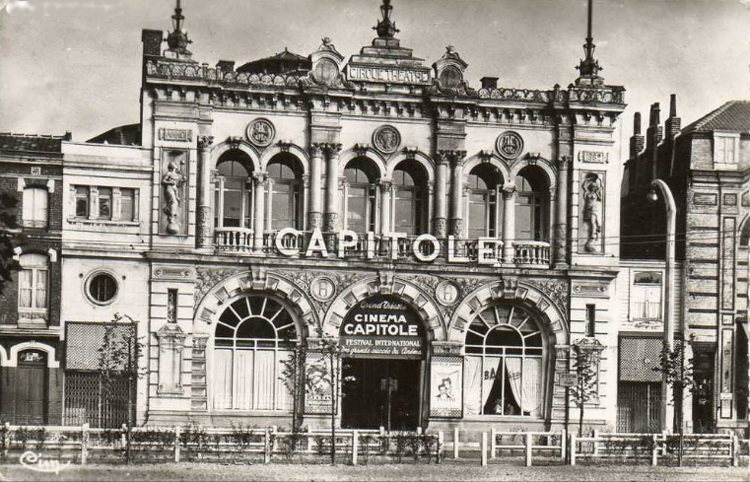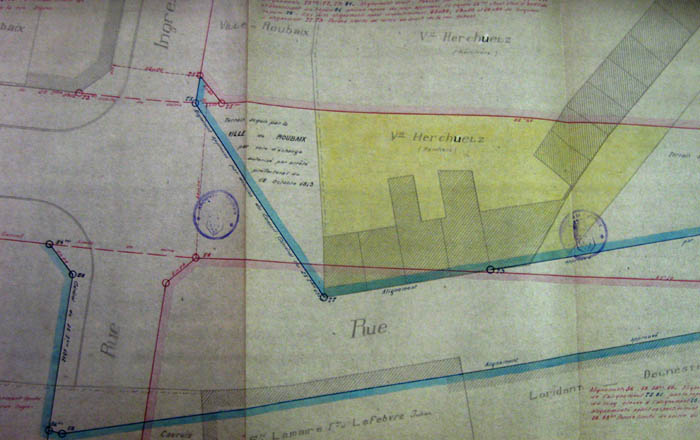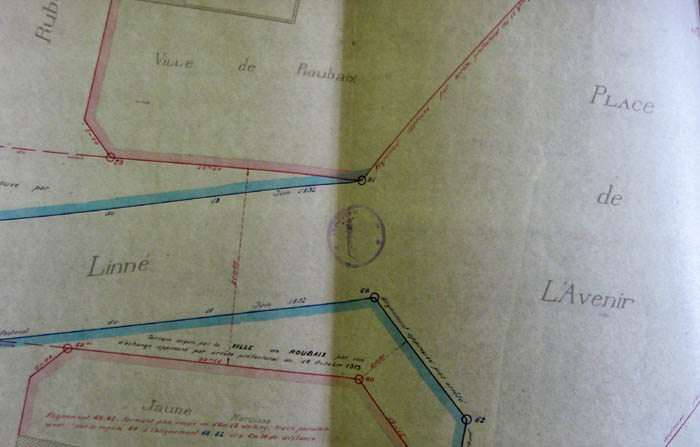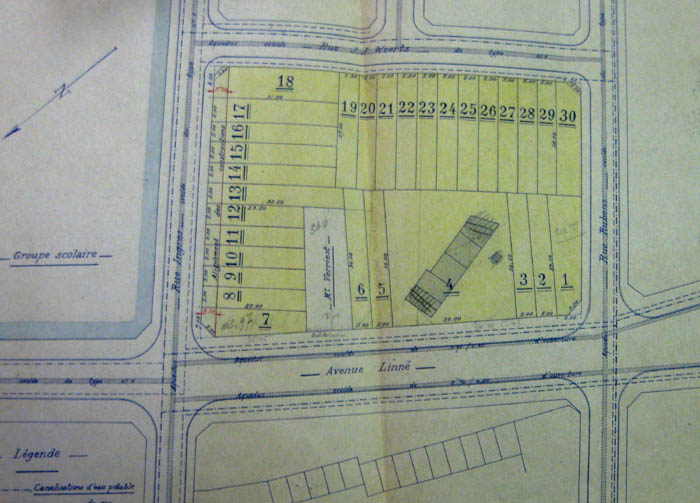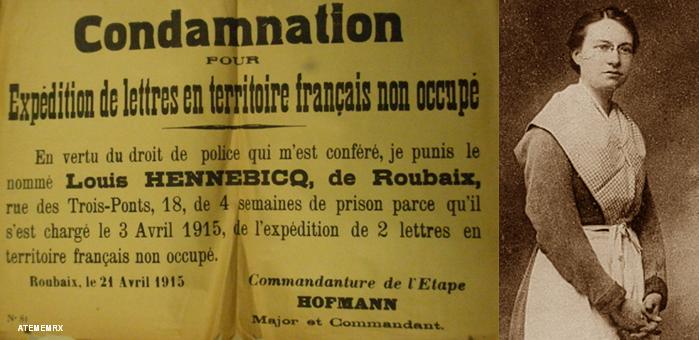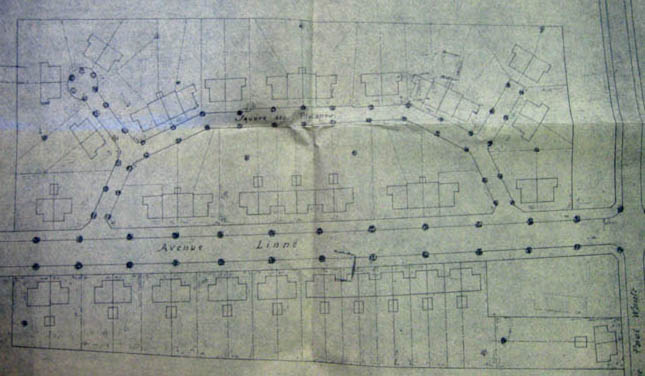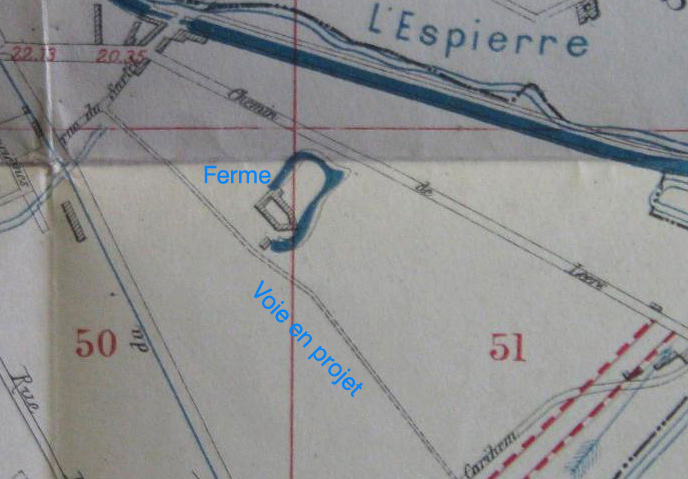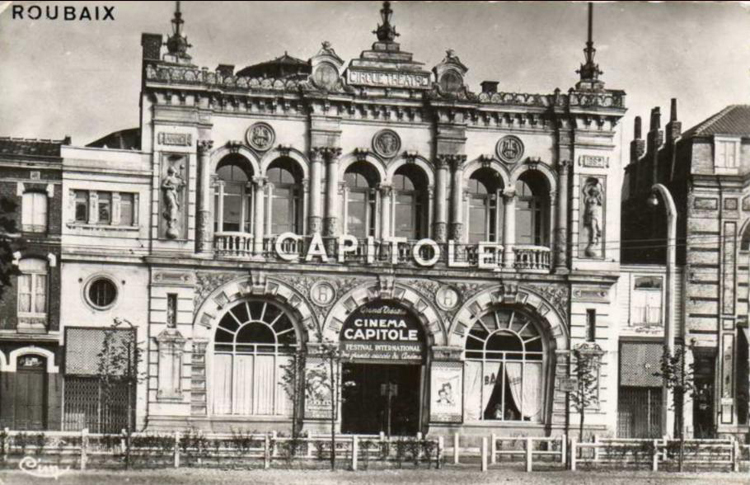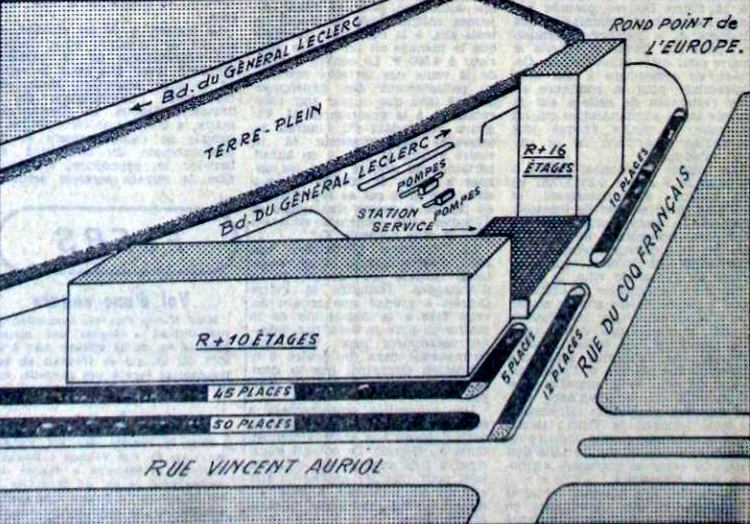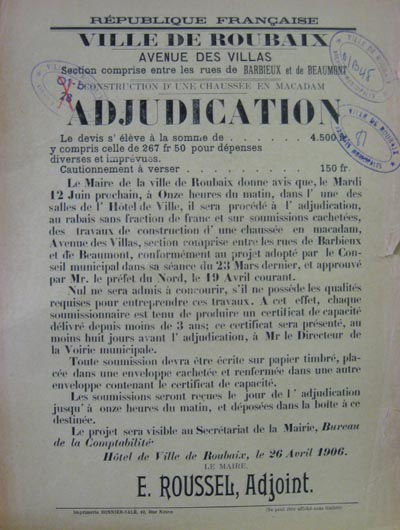La rue Jules Guesde forme avec la rue Jean Goujon un axe commercial important du quartier de la Potennerie. Au-delà du carrefour avec la rue Jouffroy, et du Coq Français, elle remplit la même fonction jusqu’au quartier du Pile. Restons-en pour l’instant à cette première partie de la rue.

Si nous suivons les numéros impairs, le photographe Charlier est au n°1, suivi de la mercerie de Mme Knoff n°3. La crémerie de Mme Delsalle au n°7, la boucherie Vandecasteele au n°9 et les établissements Ledoux, également une crémerie, au n°11-13 forment la première partie de la rue. On traverse alors la rue de Bouvines pour passer devant la bonneterie Delmé au n°23, et devant le magasin d’électricité de M.Riysschaert au n°31. Au-delà de l’impasse St Louis, on trouve au n°33 la droguerie de Mme Vandesompèle, au n°61 l’enseigne Roubaix Camping jouets, de M. Deltête, et au n°63 le café Noyelle Meersman. Après la rue de Denain, le laboratoire d’analyses médicales Dhellemes occupe le n°65, la bimbeloterie Au Petit Bonheur de Mme Dubuisson est au n°67, alors qu’au n°67 bis Mme Chuine vend des articles de ménage, puis au n°69 il y a le boucher Goffette, suivi au n°71 de la droguerie Loens.
On passe la rue des Parvenus, et se succèdent alors au n°73 la pâtisserie Bouten, au n°75 le chemisier Jouniaux, au n°77 le libraire Chapelet, au n°81 la mercerie Aux Ciseaux d’Argent, et au n°83 la lingerie Yveline. Nous traversons la rue de Ma Campagne. Là se trouvent au n°85 l’horlogerie Pruvost, au n°97 le garagiste Desodt, au n°99 la bonneterie Hautekiet, au n°103 les jouets de Mme Moura Douglou.
Après la rue de Tunis, le n°109 est inoccupé, mais pas pour longtemps, car le magasin d’articles de ménage Soetens Duyck, déjà installé aux n°111 113 va encore s’agrandir. Au n°115, un boucher hippophagique après lequel il y a au n°117 le magasin d’articles de ménage Delattre, au n°119 les chaussures Spriet, au n°121 la Société Coopérative de l’Union Roubaix Wattrelos, grossiste en vins, au n°123 le libraire Ducourant, et pour finir au n°125 le boulanger Spriet Raepzaedt.
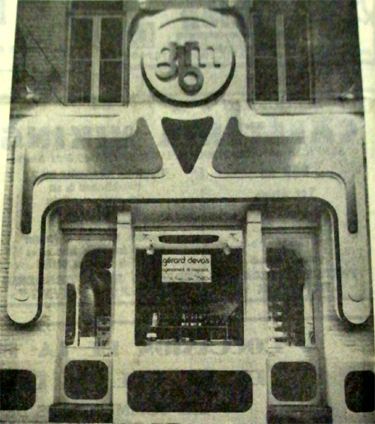
Les numéros pairs commencent par des établissements scolaires. C’est au n°6 qu’on trouve le magasin de poissons exotiques de Mme Minne, au n°12 le coiffeur pour dames Hache, au n°14 le commerce d’alimentation Ogier. Après la rue de la Potennerie, on passe devant le café A Versailles au n°16, le coiffeur Wanin au n°18, l’épicier Van Moer au n°20, le plombier zingueur Delahaye au n°24. Toujours sur le même trottoir, au n°26 Peersmann, confection pour enfants, au n°32 la boulangerie Hottebart, au n°34 le teinturier dégraisseur Anett dont la gérante est Mme Dieussaert, au n°38 l’enseigne Vins fins au détail, dont la gérante est Mme Hespel, au n°42 Bambi, le magasin de confection pour enfants de Mme Blot. Il y a encore au n°44 la bonneterie Vanhoorde Honoré, aux n°48-50 l’horticulteur Deleusière, au n°52 le commerce de beurre et œufs de M. Deleu, au n°54 Winants et Sevin, fabricants de sacs en jute, et Mme Thiry épicier, au n°56 bis le boucher Prinsie, et au n°60-62 les établissements Le Danois, électricité. On traverse la rue de Maubeuge et voici la caisse d’épargne, bureau de la Potennerie au n°62bis, l’électricité générale Nys aux n°66 68, et pour terminer ce tronçon, le boucher Depuydt au n° 72.
Il s’agit d’un relevé instantané de l’année 1973, car beaucoup de ces commerces se sont transformés ou ont disparu. Constatons qu’il y a encore une moyenne d’un commerce pour trois maisons d’habitation, et qu’il y en a encore de toutes les sortes : alimentation, confection, habillement, coiffure, articles de ménage…