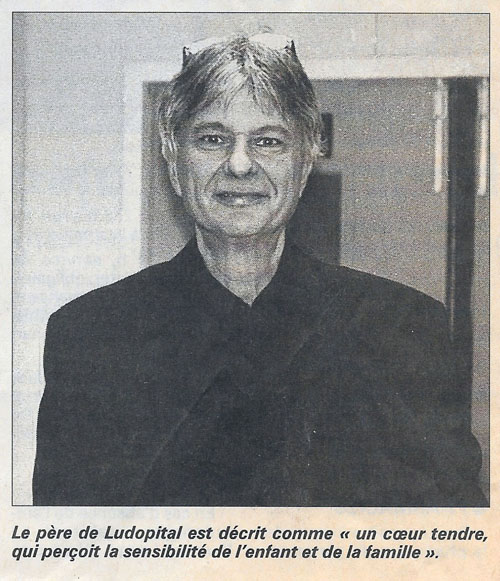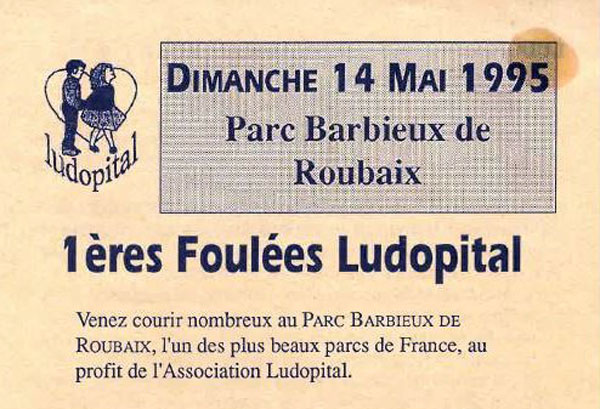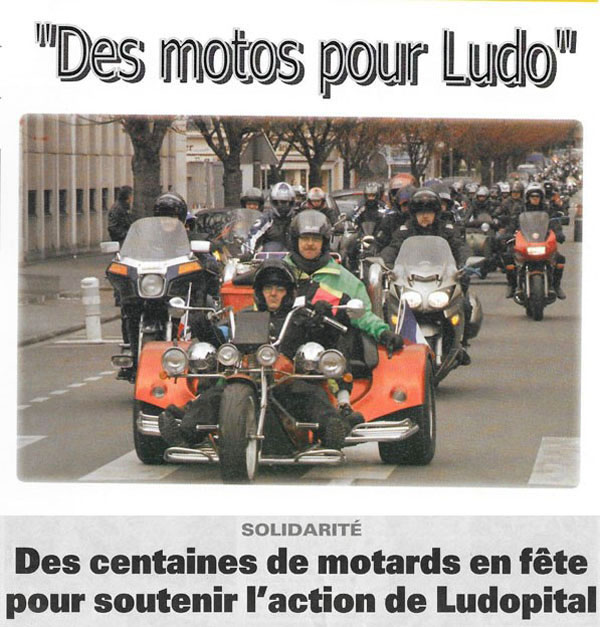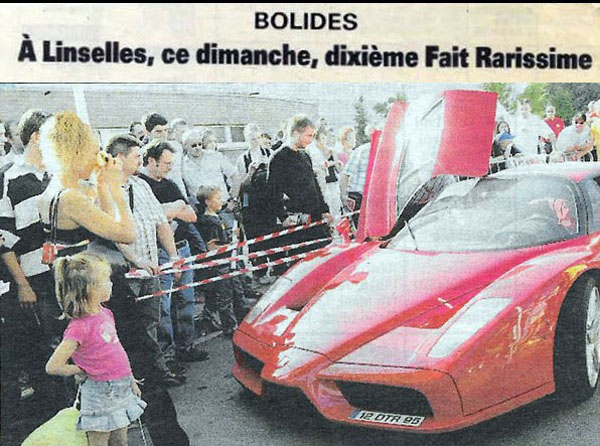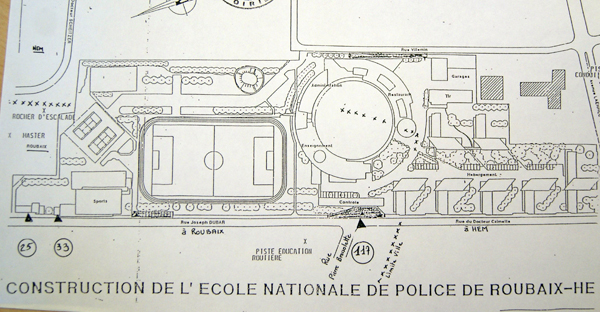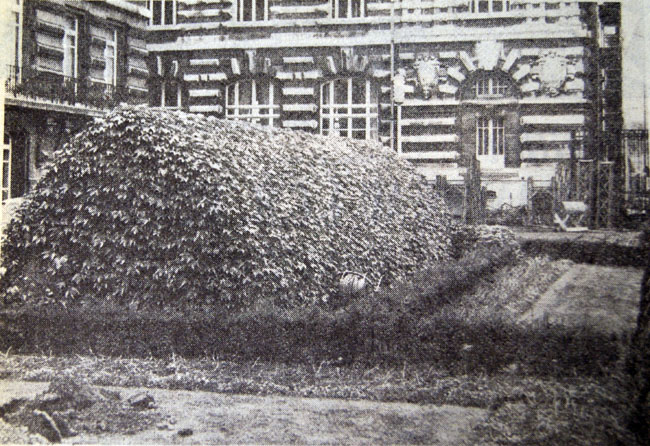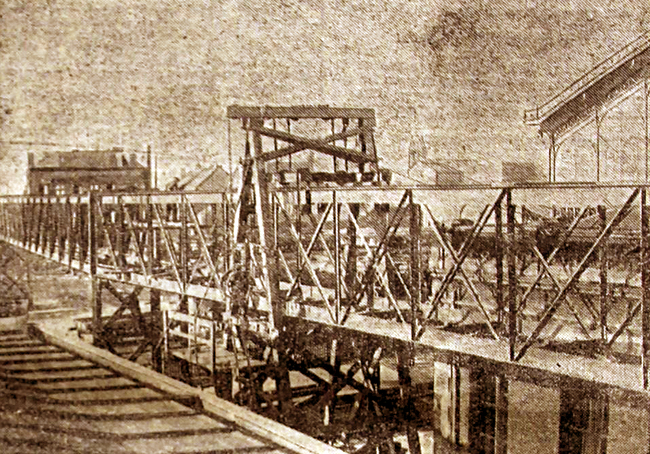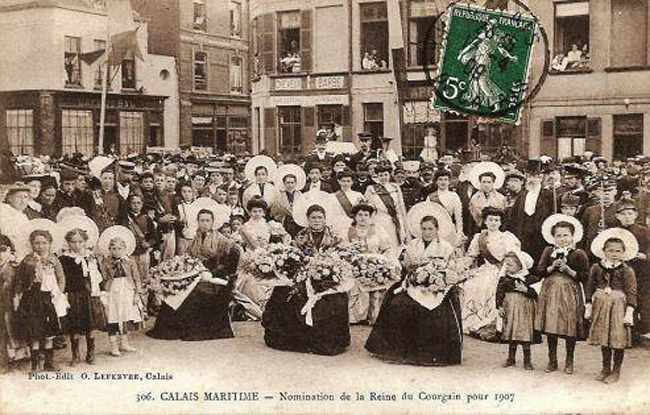Une place du quartier de l’Epeule porte désormais son nom, mais qui était donc Victor Vandermeiren ?
Victor Vandermeiren est né à Croix le 6 mars 1915 d’un père chauffeur et d’une mère soigneuse. De profession comptable, il aime à rendre service et son plaisir est de faire plaisir. Il habite 184 rue de l’industrie à Roubaix. Pendant toute sa vie, il mettra ses talents d’organisateur et de conseiller au service des gens de son quartier.
Très jeune il s’occupe de l’organisation des loisirs : en 1933, il est secrétaire de la section de basket de l’amicale des arts, il est aussi l’adjoint de son père, alors capitaine de route à la section cyclotouriste du Nord Touriste, pour l’organisation des itinéraires de randonnées.

Il fait son service militaire en Moselle au 168e RI, après ses classes il est sergent et il participe à l’organisation du foyer du soldat. En 1939, au moment de la déclaration de guerre, il est affecté comme sergent chef comptable. Fait prisonnier, il connaît la captivité dans le camp du Limbourg où il se signale par l’organisation de tournois de football, de basket. Il fait ses débuts de speaker au stalag dans un spectacle de variétés monté avec des gars du nord.
Rentré de captivité, il devient commerçant dans le quartier de l’épeule. Il est sollicité par le directeur de l’école de la rue Brézin qu’il fréquenta pour remonter l’amicale des anciens élèves. Il organise bals, kermesses, excursions, arbres de Noël. Il favorise l’arrivée du cinéma à l’école et organisa le foyer Van Der Meersch inauguré en présence de Mme Van Der Meersch, mère de l’écrivain, également ancien de l’école.
Parallèlement il participe à l’UCEA (union commerciale de l’épeule alouette) dès sa remise en marche de 1947, il en sera le vice président de 1950 à 1959. Il participe à toutes les organisations des manifestations sportives et musicales du quartier. Il devient ensuite secrétaire du comité d’entraide des fêtes de l’épeule alouette trichon en 1952. Il est un des éléments fondateurs des 28 heures à la marche de Roubaix dont il deviendra le speaker attitré.
Il n’est plus commerçant en 1959 mais son activité d’organisateur se poursuit. Secrétaire du comité des fêtes et d’entraide de l’épeule alouette trichon, il participe à la création de réalisations qui obtiennent un grand succès, comme les six jours de trottinettes, le rallye automobile, le critérium cycliste en nocturne. Il est également secrétaire du Kart club roubaisien depuis sa fondation en 1959.

Secrétaire de la section du Nord Touriste depuis 1960, membre du comité directeur des festivités de la ville, membre du comité de la section épeuloise des anciens combattants, il est partout sur la brèche. Il est de bon conseil et ses avis sont appréciés. Commissaire aux comptes de l’OMS (office municipal des sports) depuis sa création en 1965, il est l’un des membres fondateurs du comité de jumelage de Roubaix Europe dont il est un administrateur et un conseiller technique.
Il appartient depuis 1963 à l’Harmonie des anciens et jeunes soldats musiciens français, dont il est le vice-président en 1965, et au populaire orchestre des Bleus Sarraus. Ardent propagateur de l’art musical, il sera fait chevalier des arts, sciences et lettres. Il est déjà commandeur du mérite philanthropique, croix du mérite humanitaire et croix du dévouement civique !

Celui qu’on appelait affectueusement le maire de l’épeule était capable, selon son ami André Diligent, des pires coups de gueule (et puis) on redevenait amis comme si de rien n’était. Il avait une réputation de blagueur, de plaisantin, mais il aimait la fête et surtout l’organiser et l’animer. Il nous a quittés en septembre 1997.
Merci à Sylviane Catteau pour sa contribution